Jean de Préneuf, Eric Grove et Andrew Lambert (Dir.)
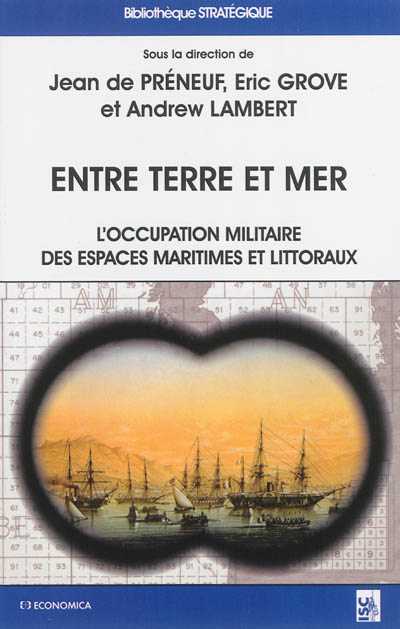
Table des matières
Introduction – Occuper la mer ? De l’application d’un concept terrestre aux espaces maritimes et littoraux
J. de Préneuf, C. Martin, M. Motte, P. Pourchasse et P. Venier
I – Penser l’occupation : la dialectique du droit, de la stratégie et de la technologie
L’occupation des espaces maritimes et littoraux : portée et limite d’une analogie à la lumière de Carl Schmitt
Martin Motte
Droit des neutres contre droit des belligérants : blocus et occupation maritime en baltique, xviie-xviiie siècles
Éric Schnakenbourg
La déclaration de Paris, “le blocus effectif” et la contrebande : l’utilité du blocus naval en tant qu’arme stratégique dans un monde en mutation
Jan Lemnitzer
La technologie navale et le développement du droit de la guerre sur mer à la conférence de Londres de 1909
Chris Martin
L’idée d’espaces maritimes et côtiers dans la pensée navale aux États-Unis depuis 1970
John B. Hattendorf
II – Défendre et contrôler un littoral : un enjeu de pouvoir
La complexe défense d’un territoire de l’empire des Habsbourg : le Pays Basque maritime au xvie siècle
Susana Truchuelo Garcia
L’occupation des espaces littoraux dans la France moderne : le cas des îles de Lérins en 1635-1637
Alan James
La police des côtes sous Napoléon Ier à l’époque du blocus continental
Catherine Denys
Le débat séculaire entre les armées sur la défense des côtes françaises et l’influence de la première guerre mondiale
Emmanuel Boulard
“Maître de maisonˮ ou serviteur ? l’occupation du littoral français, enjeu de pouvoir pendant la seconde guerre mondiale
Johannès Schmidt
La signification des bases navales à l’étranger dans la politique militaire de Staline et de Krushchev
Nataliya Egorova
La France et le littoral bulgare comme enjeu stratégique, de la Grande Guerre à la Guerre froide (1914-1991)
Alexandre Sheldon-Duplaix
III – L’occupation des eaux ennemies : l’environnement économique, politique et culturel
L’occupation espagnole en Italie et le contrôle de la Méditerranée occidentale au xviiie siècle
Augustín Gonzáles Enciso
Le blocus britannique de 1793 contre la France révolutionnaire, une tentative pour “affamer le rebelleˮ
Pierrick Pourchasse
Construction navale militaire française et approvisionnements des arsenaux face aux blocus britanniques du xviiie siècle à l’Empire
David Plouviez
La mémoire chantée d’une frontière maritime au xviiie siècle : la menace britannique sur les côtes françaises vue d’en bas
Youenn Le Prat
Vichy sous surveillance : histoire d’un “drôle de blocus”
Bernard Costagliola
IV – Occuper pour frapper : les opérations contre un littoral hostile
Puissance maritime et guerre amphibie. La marine de guerre espagnole à Minorque 1781-1782
Raphael Torres Sanchez
Course côtière, blocus maritime et descentes maritimes entre Loire et Gironde, de Louis XIV à la Révolution
Jacques Péret
La gestion du littoral oriental de la mer Noire par la flotte russe pendant les campagnes caucasiennes des années 1830-1840 : blocus, appuis et exploitations
Igor Delanoë
Interdire la mer ou s’interdire la mer ? La Marine nationale et le blocus du canal d’Otrante (août 1914-mai 1915)
Thomas Vaisset
Déployer pour protéger. Les dimensions maritimes de l’engagement britannique lors de la guerre de Bosnie (1992-1996)
Eric Grove et Alastair Graham
Durer face à un littoral hostile : la Marine nationale dans la guerre du Kosovo (octobre 1998 – juin 1999)
Dominique Guillemin
Les opérations de la Marine nationale devant le Kosovo en 1999 : le rôle du Groupe Aéronaval
Alain Coldefy
Conclusion générale : Réflexions a posteriori sur l’occupation militaire des espaces maritimes et littoraux en Europe de l’époque moderne à nos jours
Andrew Lambert
Index
Les auteurs









